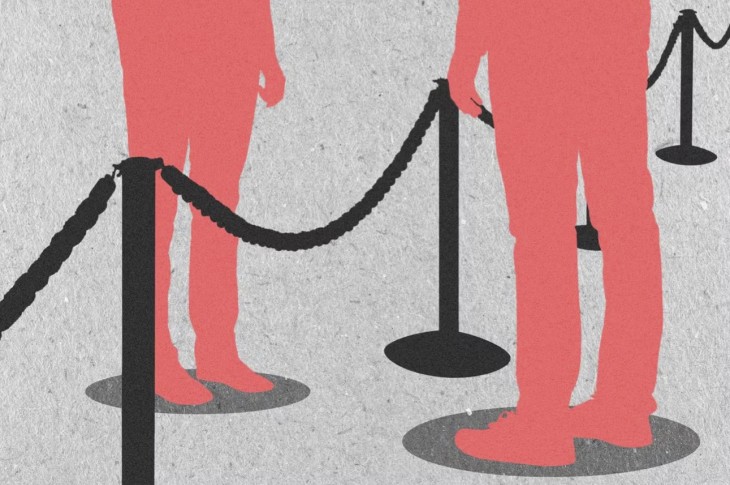
Dans une tribune au « Monde », la romancière Maryline Desbiolles rend hommage à la puissance de l’art comme lieu des utopies et de la liberté.
Cet été, à la Fondation Marguerite et Aimé Maeght [qui regroupe des milliers d’œuvres d’art moderne et contemporain, à Saint-Paul-de-Vence, dans les Alpes-Maritimes], en parcourant l’exposition « Art & Life » de la sculptrice britannique Barbara Hepworth (1903-1975), je découvre une femme engagée qui, comme d’autres artistes du collectif Abstraction-Création, estimait que la création et l’abstraction en particulier pouvaient participer à la transformation sociale et à la lutte contre le fascisme. Elle écrit en 1937 : « Le langage de la couleur et de la forme est universel et non réservé à une classe particulière… C’est une pensée qui donne la même vie, la même expansion, la même liberté individuelle à chacun. »
Je me surprends à me dire : « Voilà bien une pensée révolue, une pensée du XXe siècle », et je suis sidérée par ces mots énoncés dans le secret de mon cœur, bien plus sidérée que si je les avais proférés devant une assemblée. Alors je les profère, je les porte silencieusement en avant, je les écris dans cette tribune parce qu’ils me font honte et parce que j’ose croire qu’ils ne sont pas miens.
D’ailleurs, tout en moi s’insurge contre eux, tout ce en quoi je crois toujours, tout mon parcours. Dans les années 1970, lorsque j’étais adolescente et m’ennuyais au lycée de Cannes, où j’habitais alors, je suis venue seule en stop à la Fondation Maeght. J’ignore ce qui a pu me donner un tel désir. Rien ne me prédisposait à éprouver un quelconque intérêt pour la peinture, que je ne connaissais que dans les livres. Et c’était déjà beaucoup.
Grâces soient rendues au professeur d’histoire-géo qui, avant les grandes vacances, à la fin du collège, me fit cadeau sans un mot d’explication de quatre volumes d’une Histoire générale de la peinture, dont Les Grands Maîtres de la peinture moderne, que je découvrirais, en vrai, à la Fondation Maeght, au sein d’une architecture exaltante. Braque, Staël, Tapies ou Giacometti, j’ai été éblouie.
Et plus encore : tout autant que par les livres, ma vie a été changée par la fréquentation des œuvres d’art que cette première visite a lancée. Bouleversée par des œuvres qu’on appelle plus souvent aujourd’hui des « pièces », surtout lorsqu’elles sont contemporaines, ce qui sans doute les désacralise, mais ne les rend pas pour autant plus accessibles.
Un trop-plein de moi-même
Le piètre mot de « pièces » entérine-t-il que les œuvres ne font pas partie des arts vivants, qu’elles sont, à la lettre, dévitalisées ? D’où vient que, parfois, en effet, les œuvres m’ont l’air pendues au mur, pas seulement à cause du mot « pièces », ou que les installations délimitent un pré carré plus qu’elles ne nous affranchissent ? D’où vient qu’il me semble, parfois, que l’exposition manque de répondant ? De mouvement ? Même si la salle est bondée, à l’occasion d’un vernissage, par exemple, emplie de mes semblables, d’un trop-plein de moi-même.
Est-ce que les mots qui sont entrés en moi m’ont prise en traître parce que j’étais, non pas seule, ce qui est une joie, mais isolée, coupée du monde, séparée, ce qui me navre ? Parce que j’étais flottante en mon royaume ? Est-ce qu’on a fini par avaler ce qu’on veut nous faire croire, qu’il y aurait une culture populaire et une autre qui ne serait « pas pour nous », pas pour nous tous, une culture réservée ? Une culture qu’on devrait nous tendre avec des perches, des ficelles bien grosses, des parcs à thème où l’histoire est racontée à l’envers, des quiz, des karaokés, des parcours fléchés, un applaudimètre ? A moins qu’il ne faille que les artistes mettent de l’eau dans leur vin quitte à ne plus enivrer personne ?
Le jardin est somptueux, les salles sont magnifiques, je suis flottante en mon royaume dont l’entrée coûte cher. Mais les sculptures de Barbara Hepworth [exposées jusqu’au 2 novembre] sont à tout le monde, comme la mer qui ouvre le paysage, la mer, bien sûr, la mer, même s’il y a des plages privées et des yachts encombrants sur l’eau. Ce rivage nous a appris que les biens les plus précieux sont à tout le monde. La mer et la lumière, personne ne peut nous les confisquer. Et personne ne peut nous...
Lire la suite sur lemonde.fr






